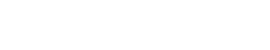150e anniversaire de la Commune de Paris
Publiée le 25 mai 2021 - Mise à jour le 25 mai 2021
 Le 28 mai 1871 s’achève la semaine sanglante, où des insurgés seront notamment fusillés devant le cimetière du Père Lachaise, où chaque année un hommage est rendu devant le mur des Fédérés. © DR
Le 28 mai 1871 s’achève la semaine sanglante, où des insurgés seront notamment fusillés devant le cimetière du Père Lachaise, où chaque année un hommage est rendu devant le mur des Fédérés. © DRIl y a tout juste 150 ans, la Commune de Paris était proclamée face au gouvernement central, enfui à Versailles. Cet épisode d’insurrection, porteuse d’un idéal de démocratie et d’égalité, s’est en partie déroulé sur le territoire de Vitry.
« Nous gagnâmes les quais, le pont Saint-Michel et l’Hôtel-Dieu, la préfecture brûlait et chaque barricade était pleine de cadavres. » Nous sommes le 24 mai 1871, une jeune Vitriote travaillant dans la capitale en fait cette terrible description. Ce sont les derniers jours de la Commune de Paris, mouvement de révolte populaire dont on célèbre aujourd’hui le 150e anniversaire.
Si cette jeune fille se désole, elle n’est pour autant pas favorable aux communards. Elle se réjouit quand ces « infâmes », selon ses mots, se font capturer, même si cela signifie pour eux la mort ou l’envoi au bagne.
C’est l’opinion d’une grande partie des Vitriots de l’époque, du monde rural, d’auteurs comme George Sand ou Émile Zola. La France vient de capituler face à l’Allemagne et veut la paix. Les insurgés rejettent quant à eux farouchement la décision du chef de l’exécutif, Adolphe Thiers, et de l’assemblée monarchiste de signer la soumission.
Pour ces Parisiens, ce serait l’humiliation suprême après des mois de siège par les troupes allemandes. Le 28 mars, ils bloquent la tentative du pouvoir central de récupérer les 227 canons de la capitale. Des combats sont engagés, le gouvernement s’enfuit à Versailles. La Commune, gouvernement révolutionnaire, est alors proclamée, et son assemblée élue s’installe à l’Hôtel de Ville. Soutenus par les fédérés, des bataillons de la garde nationale, les communards – dont de nombreuses femmes – tiennent des barricades un peu partout dans la capitale.
72 jours d’autodétermination
Acte de résistance patriotique face à l’Allemagne, c’est aussi un mouvement de franche opposition au gouvernement, jugé bourgeois et autoritaire. Un mouvement d’émancipation, porteur d’un idéal tentant de traduire en actes le rêve de “la Sociale”, de la population à majorité ouvrière de Paris. Pendant 72 jours d’autodétermination, la Commune prend des décisions tournées vers le progrès social : salaire minimum, limitation du travail de nuit, séparation de l’Église et de l’État, école laïque et gratuite, accès à l’art, reconnaissance de l’union libre, etc.
Mais le rêve prend fin dans le sang. La répression sera sans merci. À Vitry aussi. Là, les fédérés se sont installés dans une fortification militaire, la redoute du Moulin-de-Saquet, d’où ils peuvent dominer les villes alentour pour protéger Paris. Avec ses 8 canons, elle est reprise une première fois par les troupes dites « versaillaises » dans la nuit du 3 au 4 mai 1871, faisant de nombreux morts et prisonniers. Elle se rend de manière définitive à l’issue de la Semaine sanglante qui s’achève le 28 mai sur la défaite des Parisiens et l’exécution de milliers d’entre eux.
La Semaine sanglante
La haine de Thiers et de la grande bourgeoisie pour la Commune s’exprime pleinement. 130 000 soldats sont mobilisés, dont 60 000 rendus par les prussiens qui les avaient faits prisonniers, montent sur Paris. Ils bombardent Paris sans relâche, provoquant des destructions innombrables et des incendies.
Le 21 mai est le début de la « semaine sanglante ». Mille communards tombent en combattant, quinze à vingt mille sont abattus sommairement. Des conseils de guerre sont organisés qui condamnent 34 952 hommes, 819 femmes et 538 enfants à la prison. 4586 seront déportés en Nouvelle Calédonie.
Avant la Commune, il y eut la guerre contre la Prusse déclarée le 19 juillet 1870 par l’empereur Napoléon III. Il s’ensuit de nombreuses défaites dont celle de Sedan. Les français humiliés se rebellent contre le chef de l’exécutif du gouvernement, Adolphe Thiers. Les Parisiens se révoltent, prennent les armes et couvrent Paris de barricades. Les ministres quittent la ville et vont rejoindre l’Assemblée nationale à Versailles. Dès le 18 mars, le Comité central de la Garde nationale prend possession de tous les organes politiques et administratifs et organise des élections le 26 mars. Le 28 mars la Commune est proclamée. Sans attendre, elle crée neuf commissions, finances, commission militaire, justice, sûreté générale, subsistances, travail, industrie, échanges, services publics, enseignement, relations extérieures.
Des infâmes aux héros
Depuis, les communards ont été réhabilités dans de nombreux esprits. Karl Marx y voit une révolution du prolétariat, « le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs ».
En 1936, après la victoire du Front populaire, une manifestation de 600 000 personnes se déroule devant le mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise. En novembre 2016, l’Assemblée nationale vote la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871. Du côté des gilets jaunes, certains se considèrent comme leurs héritiers. Les « infâmes », plutôt des héros !
La Commune a duré 72 jours pendant lesquels il y eut des bouleversements extraordinaires pour les droits des travailleurs, un salaire minimal est instauré, pas de travail de nuit dans les boulangeries, le travail doit commencer à 5 heures. Les amendes qui frappent les ouvriers sont interdites. Les logements vacants sont réquisitionnés. Un ministère de la culture est créé, dont le ministre est Gustave Courbet (il faudra attendre 1962 pour qu’il y en ait de nouveau un). Le droit de vote des étrangers est institué….
Les rues de Vitry égrènent les noms en leur hommage. Il y a les avenues de la Commune-de-Paris et du Moulin-de-Saquet, l’école Louise-Michel (emblème féminine du mouvement), les rues Eugène-Varlin, Édouard-Vaillant, Gustave-Courbet… La rue Camélinat fait référence à Zéphirin Camélinat, directeur de la Monnaie de Paris de l’époque. C’est lui qui a frappé la monnaie de la Commune, des pièces de 5 francs marquées d’un signe distinctif, un trident. Une monnaie éphémère, certes, mais symbole de la volonté farouche des insurgés de se réapproprier leur destin.
Naï Asmar et Chrisitane Grave